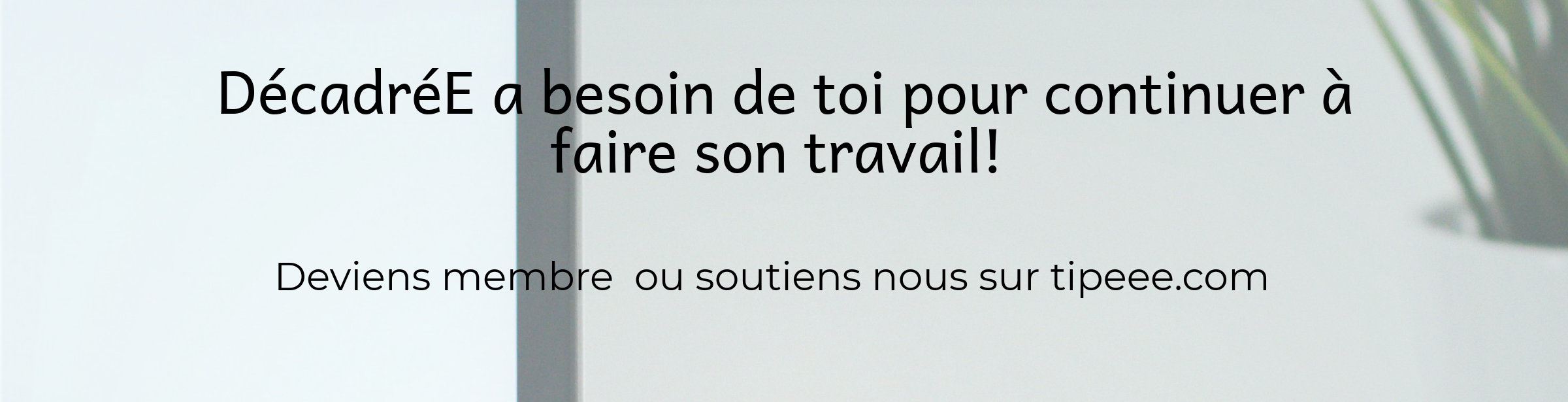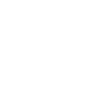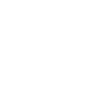Du 2 au 8 novembre dernier, le collectif français des engraineuses organisait en ligne la deuxième édition du festival écoféministe Après la Pluie; si l’écoféminisme, courant combinant problématiques écologiques et féministes, appartient pleinement à l’actualité, ses origines remontent toutefois aux années 70.
Retour aux sources.
L’écoféminisme est tout d’abord un néologisme issu des mots «écologie» et «féminisme». On attribue généralement – sans certitude – l’invention de ce terme à une Française, Françoise d’Eaubonne. En 1974, face aux prédictions désastreuses d’augmentation démographique, cette dernière expliquait que le féminisme ne pouvait plus se contenter de rechercher l’«égalité des sexes» ou «la liberté de l’érotisme»; il s’agissait désormais d’une question «de vie ou de mort». C’est pourquoi, dans le but d’échapper à la surpopulation et préserver les ressources de la planète, d’Eaubonne lançait la même année un «appel international à la grève de la procréation» où les femmes occuperaient naturellement un rôle central (Jeanne Burgart Goutal cite l’appel de Françoise d’Eaubonne dans Etre écoféministe. Théories et pratiques).
Gardons-nous cependant d’attribuer à d’Eaubonne un rôle trop central dans l’émergence de l’écoféminisme. Elle s’inscrit en effet dans un contexte de crise beaucoup plus large: en 1962, suite à la publication du Silent Spring («printemps silencieux») de la biologiste américaine Rachel Carson, toute une frange de la population occidentale prenait conscience des enjeux écologiques entourant les pesticides; à la même époque, aux Etats-Unis, s’exprimaient quantité de mouvements sociaux pour les droits des Noirs américains, des femmes, des Amérindiens… Ce terreau s’avérerait beaucoup plus fertile pour l’écoféminisme que la France.
Exploitation de la terre, exploitation des femmes – La Déclaration d’unité (1979)
En mars 1979, en Pennsylvanie, un accident nucléaire à la centrale de Three Mile Island amena des femmes militantes de différents bords idéologiques – Jeanne Burgart Goutal mentionne notamment les «radicales», les «marxistes» et les «sectatrices de la Déesse» – à se rassembler et fonder le mouvement Women and Life on Earth («Femmes et Vie sur Terre»).
Afin de concilier leurs convictions diverses, elles établirent une Déclaration d’unité:
Nous sommes des femmes qui se sont réunies pour agir d’un commun espoir en des temps de peur. Nous abordons les années 1980 dans un cri d’alarme pour le futur de notre planète. Les forces qui contrôlent notre société menacent notre existence avec l’armement et l’énergie nucléaire, les déchets toxiques et l’ingénierie génétique. […] Nous voyons des liens entre l’exploitation et la brutalisation de la terre et de ses populations d’un côté, et la violence physique, économique et psychologique perpétrée quotidiennement envers les femmes. Nous voulons comprendre et tenter de surmonter les divisions historiques basées sur la différence de race, de degré de pauvreté, de classe sociale, d’âge et de sexe.
Parallèle entre oppression de la nature et oppression des femmes. Convergences des intérêts des luttes contre le racisme, le classisme et le sexisme. Les bases de l’écoféminisme actuel étaient posées.
Mais l’importance des Women and Life on Earth ne s’arrêta pas à cette seule déclaration: sous leur impulsion,  diverses conférences et de multiples manifestations virent le jour, dont l’une des plus notables est sans doute la marche des femmes sur le Pentagone, symbole militaire par excellence, en 1980 (Women’s Pentagon Action) pour rendre hommage à toutes celles qui moururent sous les coups de la société de l’époque qu’Emilie Hache, philosophe et maîtresse de conférence à l’Université de Nanterre, décrit comme une «machine de guerre et de productivisme» dans son ouvrage Reclaim : Anthologie de textes écoféministes.
diverses conférences et de multiples manifestations virent le jour, dont l’une des plus notables est sans doute la marche des femmes sur le Pentagone, symbole militaire par excellence, en 1980 (Women’s Pentagon Action) pour rendre hommage à toutes celles qui moururent sous les coups de la société de l’époque qu’Emilie Hache, philosophe et maîtresse de conférence à l’Université de Nanterre, décrit comme une «machine de guerre et de productivisme» dans son ouvrage Reclaim : Anthologie de textes écoféministes.
Militantisme non-violent, créatif et joyeux – Le Greenham Common Women’s Peace Camp (1981-2000)
Si les Américaines de l’époque, quoiqu’essentiellement blanches et d’un certain niveau culturel, se mobilisent en masse, les Anglaises ne sont pas en reste: en septembre 1981, suite à la décision de l’OTAN d’équiper de missiles nucléaires la base de la Royal Air Force de Greenham, trente-six femmes entreprennent une marche de protestation jusque sur les lieux.
Ignorées des autorités, elles décident d’y installer un campement, le Greenham Common Women’s Peace Camp («Le camp commun des femmes pour la paix»), rendu non-mixte en 1982; comme l’explique l’une des participantes, Di McDonald dans The Guardian: «il n’y avait pas beaucoup de groupes de femmes avant Greenham, et ceux qui existaient avaient des hiérarchies, des uniformes, des capitaines et étaient organisés selon le modèle masculin. Mais à Greenham, tout le monde était à égalité et tout le monde avait l’opportunité de parler ou non durant une réunion, parce qu’il n’y avait pas de chefs». Cette organisation non-hiérarchique de femmes issues de différents milieux professionnels, militants et sociaux de l’époque n’est pas sans évoquer les Women and Life on Earth, tout comme leur vocation antinucléaire.
L’occupation des lieux dura dix-neuf ans, durant lesquels de multiples actions non-violentes furent entreprises: chaînes humaines autour des grillages, die-in (manifestations lors desquelles les participant-e-s simulent leur mort), chansons, pique-niques costumés et danses sur les toits.
 Les femmes de Greenham escaladant les grillages déguisées en ours en peluche
Les femmes de Greenham escaladant les grillages déguisées en ours en peluche
On ne saura jamais si elles furent cause ou non de la signature, en décembre 1987, entre les gouvernements américain et russe, d’un traité visant à respectivement réduire leur stock d’armes nucléaires. Mais, comme l’explique Fran De’Ath, dans The Guardian également, là ne résidait pas l’essentiel: «Greenham était une expérience puissante. Elle enseigna à ma génération l’action collective, la protestation comme spectacle et manière de vivre, incroyablement difficile mais parfois joyeuse. Pour moi aujourd’hui encore, l’image de la résistance […] est le souvenir des femmes de Greenham dansant en 1982: des femmes ensorcelantes, désarmées, dansant sur un silo à missile».
Car l’écoféminisme, avant d’être mouvement d’idées, se veut d’abord mouvement d’actions, non-violentes et inventives, créatrices et unificatrices, ce qui n’est pas sans évoquer l’expression consacrée de l’anarchiste russe Emma Goldman (1869-1940), «si je ne peux pas danser, ce n’est pas ma révolution».
Etre ou ne pas être écoféministe – Le mouvement chipko (1973) et la ceinture verte (1977)
Si les écoféministes revendiquées de l’époque étaient essentiellement des femmes blanches et anglo-saxonnes d’un certain niveau social et culturel, les intérêts environnementaux n’étaient de loin pas leur seul apanage…
Au nord de l’Inde à Gopeshwar, en 1964, comme l’explique Shobita Jain, sociologue de l’Université des Antilles, des Indiens créèrent la coopérative ouvrière Dasholi Gram Swarajya Mandai (DGSM) afin de créer de nouveaux emplois en lien avec l’exploitation des forêts. Elle fut peu considérée par les autorités indiennes. En mars 1973, une entreprise étrangère de fabrication d’accessoires de sport, la Simon Company, obtint l’autorisation d’abattre des arbres dans la même région, au détriment de la DGSM. Le 27 mars 1973, les habitants s’opposèrent formellement à la déforestation. Un mois plus tard, les ouvriers et les villageois des environs, soit une centaine de personnes, marchaient de Gopeshwar sur Mandal, au son des tambours et de leurs chants traditionnels. Les agents de la Simon Company et leurs hommes se retirèrent alors sans couper un seul arbre.
Au-delà des questions économiques que posait une telle confrontation, les femmes de la région, très connectées à leur environnement naturel direct puisque ce sont elles qui d’ordinaire s’occupent des cultures et du bétail, réalisèrent que les travaux des entreprises étaient cause de crues répétées et de glissements de terrain qui mettaient à mal leurs biens et leur survie. Leurs intérêts convergeant avec ceux de la DGSM, elles s’y associèrent. Dès 1973, elles entreprirent des actions de protection de leurs forêts en prenant notamment des arbres dans leurs bras pour dissuader les bûcherons de les abattre. Elles s’inspiraient ainsi d’une certaine Amrita Devi qui, déjà en 1730, avait agi de façon similaire. Le mouvement chipko – de l’hindi «étreinte» – était né.
 Les pionnières du mouvement chipko (Inde,1973)
Les pionnières du mouvement chipko (Inde,1973)
Suite à leur participation active au mouvement, reconnues désormais comme des conseillères de poids sur les questions touchant à l’environnement, les femmes, petit-à-petit, furent invitées à participer aux réunions de leur village où jusqu’alors on ne les avait jamais vues.
Bien qu’elles ne se soient jamais revendiquées écoféministes, leurs activités furent rattachées à ce courant a-posteriori par Vandana Shiva, figure de proue réputée et controversée de l’écoféminisme en Inde aujourd’hui encore. Cette dernière consacre une partie de ses engagements à décoloniser le féminisme, parfois jugé trop «blanc» ou «individualiste» dans sa quête d’obtention de droits pour les femmes, droits qui ne prennent pas en considération leur environnement naturel ou la globalité du système auquel elles appartiennent.
Citons également le Green Belt Movement («Mouvement de la ceinture verte»), fondé en 1977 au Kenya, «pour répondre aux besoins des femmes de la campagne kenyane qui rapportèrent que leurs cours d’eau s’asséchaient, que leurs réserves de nourritures étaient moins assurées et qu’elles avaient à marcher de plus en plus loin pour obtenir du bois pour le feu et les clôtures». Là encore, nulle mention d’écoféminisme, mais des intérêts proches de ceux que le mouvement «officiel» revendique.
Poser le doigt dans le rouage de l’écoféminisme, c’est se retrouver confronté-e à une «nébuleuse» complexe, pour reprendre le terme de Jeanne Burgart Goutal, d’actions et d’intérêts confluents; derrière un seul mot, c’est un ensemble de choses qui se dissimulent et qui, loin de constituer un système cohérent, s’entrechoquent, se contredisent. Quels points communs entre une organisatrice du festival Avant la Pluie, une militante de Greenham et une chipko? Un terme, «écoféminisme». Maigre et imprécis. Parfois abusif.
Mais, au-delà de ce mot, c’est bien un champ considérable d’actions citoyennes non-violentes et inclusives qui s’ouvre, une lutte à des degrés multiples pour tendre vers des changements sociétaux respectueux de l’environnement et des unes et des autres. Pour un monde plus conscient des liens intrinsèques, fondamentaux, entre tout être-vivant, animal, végétal… Une seule question subsiste: par où commencer?
Image de titre:
La chaîne de femmes de Greenham (Angleterre, 1982)