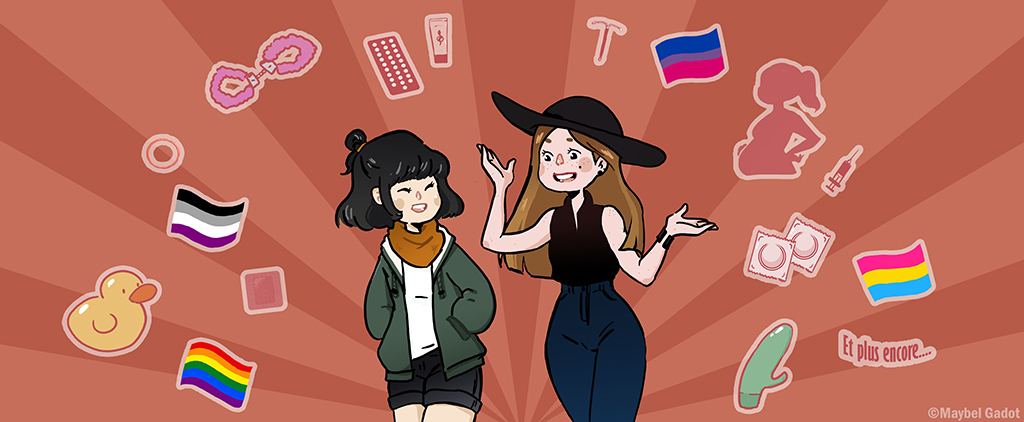Chaque mois, Romy Siegrist vous propose une réflexion/discussion autour d’un thème sexo particulier. De la pluralité des expériences aux vécus singuliers, n’hésitez pas à échanger avec nous!
La question du désir est relativement courante dans notre société occidentale. Qu’elle soit utilisée pour vendre (bonjour les pubs sexistes) ou qu’elle soit pensée comme «thermomètre» mesurant l’amour que nous aurions envers unE partenaire (#nemélangeonspastout), on en fait quelque chose de central, d’évident. Et tout cela implique une certaine pression: le désir, c’est quelque chose qu’il faudrait avoir.
Il est également courant d’entendre que le manque nourrit le désir. Mais le désir, en fait, ça marche comment? Est-ce vraiment le manque qui le crée? Essayons de voir les choses autrement…
Commençons peut-être par distinguer désir sexuel et excitation sexuelle, même si à certains moments ielles s’entremêlent (les coquinEs). Le premier serait plus une forme d’envie, de projection mentale vers un plaisir, et la deuxième un processus physiologique qui s’enclenche grâce à certaines stimulations. TouTEs deux peuvent être plaisantEs, et certaines personnes ont leur préférence. T’es plutôt désir ou excitation? Posez la question à vos amiEs et amantEs.
Quoiqu’il en soit, quand on parle de désir, on traîne tout un vocabulaire qui peut amener certaines représentations. Cela peut valoir le coup d’en prendre conscience, et d’éventuellement les modifier.
Le désir viendrait d’un manque
Comme si, au moment de désirer, nous étions incomplètEs, que nous cherchions à combler des besoins, des envies, grâce à l’autre. Cela amène une relation forcément déséquilibrée, avec des enjeux de pouvoir et d’emprise: l’autre aurait donc la responsabilité (et le devoir) de satisfaire nos besoins. Et en matière de sexualité, il n’est pas inutile de rappeler que le spectre du «devoir conjugal» a plané longtemps sur les lois, en Suisse aussi. Bien que ce ne soit plus le cas, il est encore courant de définir et penser le couple comme le lieu de la sexualité, comme si, sans sexualité, un couple n’est plus «qu’une amitié»… Cela en dit long sur notre perception et notre amalgame entre amour et sexualité, ainsi que sur notre hiérarchisation des relations en fonction des liens de sang, bien sûr, mais aussi des rapports sexuels… ça ne donne pas un peu envie d’anarchie relationnelle?

Parler de manque comme moteur au désir implique donc des enjeux de pouvoir dans les relations intimes. Il est intéressant également de se décentrer, et de voir ce que cela peut provoquer chez l’autre, qui reçoit ou perçoit ce désir conçu à partir d’un manque. Dans le premier épisode du podcast «Les Artichauts» de Bettina Lioret, Esther Perel (thérapeute de couple et sexologue de renommée internationale) évoque sa conception de la dynamique du désir, de l’intelligence érotique (vous pouvez d’ailleurs lire son ouvrage éponyme, il est très intéressant).
Ce que soulève notamment Esther Perel, c’est que ce qui rend désirable est une forme d’autonomie. En gros «on tient sans l’autre», et cela fait que cetTE autre n’a pas à nous porter, à se sentir responsable de nous, ce qui vient alors limiter les dynamiques relationnelles de type parent-enfant – assez peu attrayantes sexuellement. Par ailleurs, l’autre est perçu comme plus désirable lorsqu’ielle rayonne, qu’ielle est dans son élément. Peut-être lorsqu’ielle est pleinE?

La plénitude comme origine du désir?
Bien sûr, il y a plein de raisons de vouloir avoir du sexe (se sentir proche de l’autre, apaiser des tensions, avoir du plaisir, etc.), et ces motivations sont aussi intéressantes à penser. Mais poursuivons autour de la question plus précise du manque vs de la plénitude, de la complétude, comme origine du désir en soi et en l’autre. Passer du désir par creux au désir par plein.
Esther Perel précise également dans “Les Artichauts” qu’une personne doit connaître sa valeur pour oser désirer et s’en sentir légitime, «to own the wanting», avec l’idée que si l’on ne s’aime pas, on ne va pas vouloir nous imposer à l’autre. Un peu réducteur, mais assez pertinent.
Si l’on va plus loin, se sentir pleinE, autonome, responsable de notre propre vie, permet d’accepter l’équivalent chez l’autre. Cela permet aussi de cesser de se penser et de penser l’autre comme “notre moitié” (re-bonjour l’incomplétude). En fait, être en relation avec telle ou telle personne n’est pas, ou plus, un besoin mais un choix. Pour poursuivre la réflexion, cet article de blog, intitulé “Je n’ai pas besoin de toi mais je veux être avec toi” soulève quelques idées et formulations intéressantes…
Et je vous laisse avec Peter et Sloane, puisque c’est dans la même veine (et que ça rayonne…)!