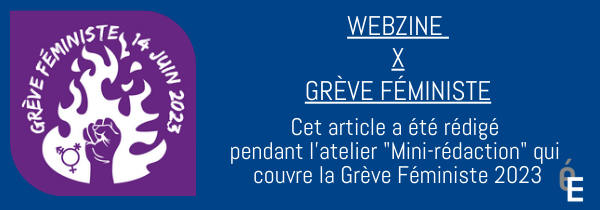Fatigue militante, le combat invisible
Auteurice Erica Berazategui, 17 juin 2023Illustrateurice Elizabeth M
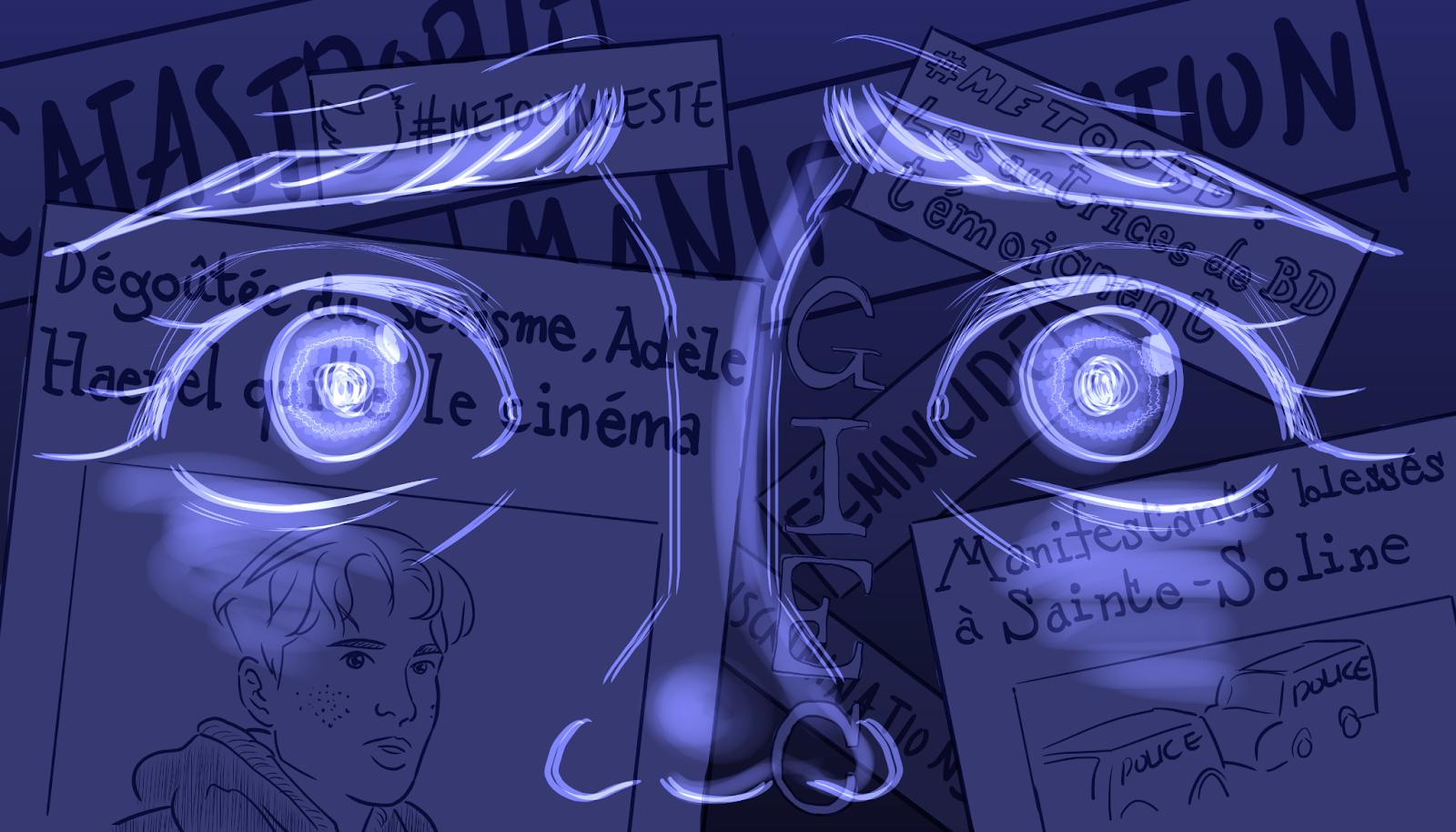
Voilà, la grève féministe du 14 juin 2023 c’est terminé. Et maintenant? On se repose ou on reprend la lutte directement? Entre épuisement, désillusion ou ras-le-bol, continuer à lutter peut s’avérer difficile pour certain-e-xs: la fatigue militante pointerait-elle le bout de son nez?
Pour la petite histoire, le webzine de décadréE a organisé cette édition spéciale grève en avance. C’était donc prévu depuis un moment que cet article soit publié le 17 juin. Et pourtant, me voilà en train d’écrire ces lignes le mardi 13 juin à 21h16 . C’est pas mon genre de laisser les choses pour la dernière minute, ni de travailler après 19h. Mais alors, que s’est-il passé? Je vous réponds simplement: la vie (et une pointe de procrastination, je vous l’accorde). Je n’ai pas trouvé le temps de me pencher sur la rédaction de cet article: soit une activité bénévole que je fais sur mon temps libre, avec une motivation militante.
Je me sentais fa-ti-guée.
Ce n’est pas pour vous étaler mes lamentations que je raconte ça; c’est pour illustrer mes propos. Même si je ne me considère pas comme militante au même titre que les personnes engagées dans les différents collectifs de la grève, l’objet que j’explore ici ne fait pas de différence entre écrire des articles et organiser une grève nationale: la fatigue militante peut toucher n’importe quelle forme d’engagement.
Fatigue ou burn-out: quel mot utiliser ?
Si l’on se réfère à la définition du terme «fatigue» du Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), il existe plusieurs types de fatigue.
L’une d’elle est physiologique. Transposée au militantisme, il s’agirait d’un épuisement physique suite à de trop nombreuses heures investies dans une cause.
Un autre type de fatigue correspond à une forme figurée: il s’agirait d’un épuisement mental lié à un découragement, à la disparition de motivation, ce qui s’applique complètement au militantisme.
La dernière fatigue proposée par ce dictionnaire est la «moindre résistance (d’une chose) due à une trop longue ou trop violente utilisation et pouvant aller jusqu’à empêcher son fonctionnement normal.» ce qui, à peu de choses près, pourrait correspondre à l’empêchement d’un-ex militant-ex de fonctionner normalement dû par exemple aux premières fatigues que l’on a vu.
Si l’on mixe ces types de fatigues, on s’approche de la définition du terme «burn-out» (du Larousse cette fois; le TLFi ne connaît pas les anglicismes – il propose ce mot lorsqu’on recherche burn-out dans la barre de recherche): Syndrome d’épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense, générée par des sentiments d’impuissance et de désespoir.
Parlons alors de burn-out militant, même si ce terme est généralement appliqué au domaine professionnel et utilisé qu’en cas «extrêmes». Car oui, c’est bien joli de classer différents types de fatigue mais dans les faits, est-ce qu’elles sont dissociées? Pas vraiment, comme en témoigne Ella, membre du collectif Vaud de la Grève Féministe: «Tu peux atteindre un point auquel tu n’arrives plus à t’investir dans les causes qui te tiennent à cœur car tu es trop impliqué-ex émotionnellement jusqu’à ce que ça devienne physique».
Comment surgit le burn-out militant?
Cette fatigue est souvent liée à un certain nombre de facteurs. Commençons par citer le trop plein de tâches dont plusieurs personnes de différents collectifs cantonaux peuvent attester: les différents collectifs de la grève manquent cruellement de personnes impliquées. De ce fait, les personnes impliquées doivent organiser un événement de l’ampleur dont nous avons été témoins le 14 juin en sous-effectif et donc, à crouler sous les responsabilités.
A ce trop plein de tâches vient s’ajouter le phénomène appelé backlash que Camille, membre du collectif de Neuchâtel, qualifie d’«attaque de l’opposition». Il peut se traduire par un manque de considération ou une remise en question des revendications de la part des personnes ne se sentant pas concernées par la lutte qu’elles attaquent . Ces offensives ont généralement pour conséquences un découragement et une forme de désillusion quant à l’avancée de la cause.
Pour Marianne*, membre du collectif Genevois très active principalement en 2019, les origines de cette fatigue militante sont très profondes: il faut remonter toutes les couches du patriarcat (qui l’eut cru?) pour les trouver. Selon elle, «la culture de l’engagement militant est relativement récente en Suisse pour les femmes. Le militantisme a pendant longtemps été une histoire masculine: il est conçu pour les hommes par les hommes, ce qui rajoute des difficultés supplémentaires pour les femmes.» Au début de l’entretien, elle a dit, en riant jaune, que le militantisme est «une activité non-rémunérée de plus pour les femmes »». La boucle est bouclée: les personnes impliquées dans les collectifs en sous-effectifs se retrouvent avec trop de responsabilités bénévoles à tenir en parallèle d’une vie professionnelle et personnelle.
Et les solutions?
Camille évoque immédiatement «le mal du siècle» pour parler du burn-out, dont le burn-out militant est une déclinaison. Existe-t-il alors des solutions pour le prévenir?
Dans les collectifs représentés par les trois personnes interviewées, soit à Genève pour l’année 2019, Neuchâtel et le groupe de travail du collectif Vaud dont fait parti Ella, rien de concret n’est mis en place pour prévenir directement le burn-out militant:
«La fatigue militante n’est pas abordée frontalement dans mon groupe de travail, par manque d’argent, de temps… bien que tout le monde soit transparent-ex quant aux limites du mouvement, c’est aux individus de prendre soin d’elleux.» raconte Ella. Le constat est le même à Neuchâtel.
Camille rebondit immédiatement en affirmant que la meilleure prévention reste la «liberté de s’investir comme on le souhaite et de savoir poser ses limites». Cependant, elle reconnaît que cette liberté a elle-même des limites dues à un manque de ressources, ce qui implique parfois de renoncer à certaines actions pour se protéger. Malgré tout, ces choix et cette liberté sont toujours entendus et respectés au sein du collectif.
Selon Marianne*, la solution à cette fatigue devrait être radicale: «revoir le système». Mais elle souligne aussi que «même celles qui s’engagent quelques minutes, pour des petites actions du quotidien par exemple, font avancer la cause. (…) Rien n’est acquis mais tout est bon à prendre.»
Fatigue, pureté militante et intersectionnalité: compatibles?
Soyons clair-exs: le but de cet article n’est pas de blâmer les collectifs qui ne mettent pas en place des solutions concrètes pour prévenir l’apparition de fatigues militantes, ou de se décourager en constatant la rigidité du système. Il est cependant important de rendre visible le burn-out militant et de mettre en avant qu’à cause d’un manque d’effectifs et de ressources, l’énergie du collectif ne peut pas être investie là-dedans.
Penchons-nous maintenant sur une notion qui peut nous intéresser pour aller plus loin. Le concept de pureté militante, si l’on se réfère à la définition de notre chère Wikipedia, «est une injonction à avoir un comportement parfait dans certains cercles militants (…).». On peut traduire ça par une pression interne aux mouvements qui pèse sur ses membres à être le plus déconstruit-ex possible et à chercher à atteindre un mode de vie complètement en phase avec ses valeurs militantes. Ce danger est aujourd’hui accru par tous les combats à mener en parallèle: peut-on s’investir corps et âme dans plus d’une cause, par exemple grève féministe et grève du climat? Pour reprendre les termes de Marianne*, «à moins d’être riche ou un-e retraité-exs confortable-xs, toutes les luttes actuelles, qui sont justes, […] paraissent incompatibles à concilier.»
Alors surtout, surtout, ne culpabilisons pas! Comme le dit Camille avec une certaine émotion, il peut être parfois difficile de se rendre compte des actions qui ont déjà été menées tant la désillusion ou la fatigue peuvent être importantes. Dans ce cadre, il est d’autant plus important de ne pas s’en vouloir de ne pas réussir à s’investir autant que souhaité et surtout, ne pas se comparer aux autres: les limites et possibilités sont personnelles. De même, il est fondamental de ne pas en vouloir aux personnes qui en font moins que soit: «J’ai parfois de la peine à comprendre pourquoi les personnes ne peuvent pas en faire plus» explique Ella. Elle poursuit: «C’est une frustration que j’essaye d’analyser. J’ai des attentes personnelles que je transpose parfois sur les autres alors que chacun-e gère sa vie et son militantisme à sa manière. C’est aussi ma responsabilité de laisser les autres prendre de la place mais c’est parfois difficile.»
Soyons indulgent-exs envers nous-même et envers les autres <3
Petit tips: La care team de la grève du climat suisse a posté en février 2022 une liste de questions/recommandations pour reconnaître le burn-out militant: https://climatestrike.ch/fr/posts/glorification-burnout-activism.
*Prénom fictif