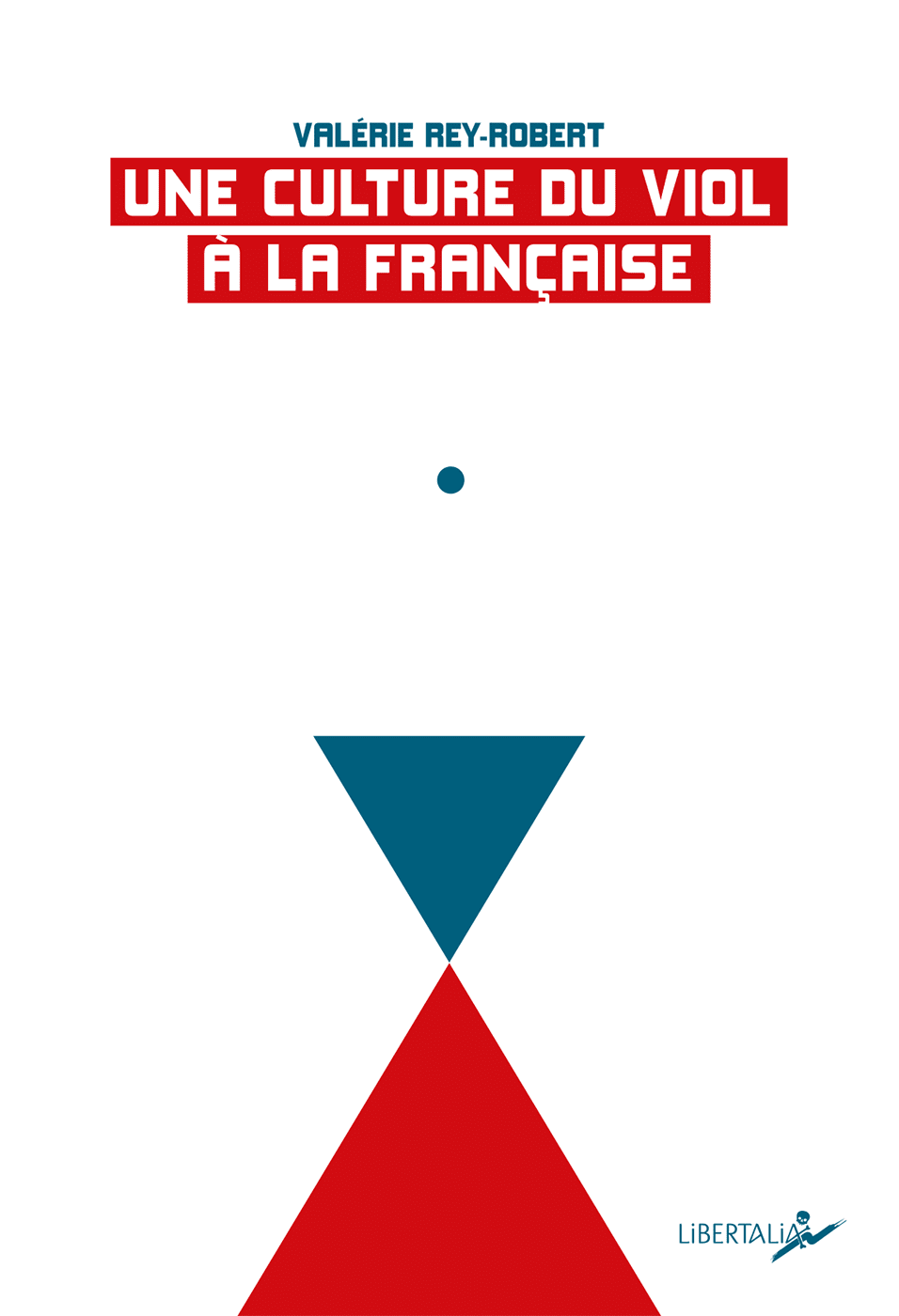Une culture du viol à la française: préjugés et impunité des violences sexuelles
Auteurice Alizé Tromme, 30 septembre 2020Illustrateurice
Dans son livre Une culture du viol à la française, la blogueuse féministe Valérie Rey-Robert analyse les préjugés sur les violences sexuelles qui aident à perpétuer ces crimes. Elle dépeint plus exactement comment ces mécanismes complexes s’articulent en France, où la culture de la séduction sert souvent de prétexte pour dédouaner ces crimes. Critique.
Quel est le rapport entre Angèle, des lycéennes et un ministre français? Chacun-e est un exemple récent de l’étendue de la culture du viol dans la société française. Lorsque le frère de la chanteuse d’origine belge est accusé d’agressions sexuelles, c’est à elle que l’on vient demander des comptes, comme le rapporte le Huffpost. Sommées par le ministre français de l’éducation Jean-Marie Blancher de porter des tenues plus “républicaines” pour se rendre à l’école, des lycéennes ont protesté sur les réseaux sociaux contre ce qu’elles considèrent être un règlement sexiste. Enfin, Gérard Darmanin, ministre français de l’intérieur, est accusé de viol et obtient cependant le soutien du président Macron.
Nos tenues ne sont pas le problème.
Le problème, c’est le harcèlement, les agressions et les viols.Soutien à toutes celles et ceux qui refusent la culpabilisation des femmes. #Lundi14Septembre
— #NousToutes (@NousToutesOrg) September 13, 2020
Selon ONU Femmes, la culture du viol est «l’environnement social qui permet de normaliser et de justifier la violence sexuelle, alimentée par les inégalités persistantes entre les sexes et les attitudes à leur égard.» Le terme est apparu pour la première fois aux Etats-Unis dans les années 1970 et s’est passablement répandu dans le monde anglo-saxon. Si l’expression est arrivée plus récemment en France, les spécificités de son application dans ce pays ont été analysée par Valérie Rey-Robert dans son livre Une culture du viol à la française.
Origines et idées reçues sur le viol
Militante et créatrice du blog féministe Crêpe Georgette, Valérie Rey-Robert détaille dans son ouvrage les mécanismes à l’œuvre derrière la culture du viol et les préjugés qui permettent son maintien à grande échelle.
Pour elle, le sexisme est à l’origine de cette culture. Nous vivons en effet dans une société où les besoins des hommes passent avant ceux des autres, où les rôles genrés traditionnels persistent et où le patriarcat en général dévalorise la place et la parole des femmes. Les violences à l’égard des femmes sont généralisées et plusieurs facteurs sont à l’œuvre pour permettre leur pérennisation. C’est ce que l’autrice nomme les idées reçues sur le viol. Ces dernières visent principalement à déresponsabiliser les coupables, culpabiliser les victimes et invisibiliser les violences sexuelles.
Parmi ces idées reçues, on peut notamment citer la croyance que le violeur est toujours un inconnu, alors que les statistiques montrent que la victime connaissait son agresseur dans la grande majorité des cas. Selon une enquête de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) datant de 2013, l’agresseur est un proche connu dans le trois-quart des cas. De même, les auteurs de viol sont très souvent des personnes d’apparence tout à fait banale et non pas des criminels souffrant de problèmes mentaux. Ces préjugés concourent à maintenir l’idée que le viol est un crime rare et uniquement perpétré par des individus dangereux et anonymes, alors que la vérité est à l’exact opposé.
La remise en question des paroles des femmes, jugées menteuses ou hystériques, est une autre de ces idées préconçues. Tout comme la culpabilisation des victimes. Leur attitude ou leur apparence physique sont presque systématiquement mentionnés et justifieraient les agressions que ces personnes ont subies. Parmi de nombreux exemples, on peut citer cette récente agression subie par deux femmes à Mulhouse au motif que leur jupes étaient trop courtes. Cette excuse explique également pourquoi les plaintes sont rarement prises au sérieux. Malgré les statistiques et enquêtes menées prouvant que ces croyances sont erronées, elles restent ancrées dans l’imaginaire collectif et maintiennent une société qui entretient les violences sexuelles.
Au pays de «l’amour courtois»
Selon Valérie Rey-Robert, cette culture du viol peut s’articuler différemment selon les pays et elle a choisi d’étudier le cas de la France. Dans son livre, elle examine l’histoire du traitement et de la pénalisation du viol dans l’Hexagone depuis l’Ancien Régime. Elle analyse ensuite les statistiques des différentes enquêtes réalisées sur le sujet et les confronte aux idées reçues des français-es sur les viols et violences sexuelles.
Face à ces préjugés, elle constate aussi une particularité qui semble propre à ce pays. Elle cite la chanteuse et actrice Isabelle Adjani qui explique qu’en «France, c’est autrement plus sournois. En France, il y a les trois G: galanterie, grivoiserie, goujaterie. Glisser de l’une à l’autre jusqu’à la violence en prétextant le jeu de la séduction est une des armes de l’arsenal de défense des prédateurs et des harceleurs.» Il y aurait cette idée que, notamment face à la trop puritaine Amérique, la séduction fait partie intégrante de la culture française. Cela expliquerait, selon l’autrice, le manque de distinction entre ce qui est considéré comme un viol ou non, ainsi que la défense des harceleurs, excusés sous le couvert d’être des «séducteurs».
Dans cette optique, on peut citer l’exemple de la tribune pour la «liberté d’importuner» publiée dans Le Monde qui est révélatrice de cette pensée. Signée par un collectif de 100 femmes, elle serait «indispensable à la liberté sexuelle» et s’oppose à un féminisme qui exprime une «haine des hommes». Les violences sexuelles sont ainsi minimisées ou niées sous couvert d’une «tradition française de la séduction», qui s’ajoute à l’arsenal des préjugés servant à défendre les violeurs.
Imaginer des relations amoureuses sans rapport de domination
L’autrice conclut que pour lutter efficacement contre cette culture du viol, il est nécessaire de déconstruire les stéréotypes de genre et la domination masculine. Ce combat contre les idées reçues passe notamment par l’éducation ou le travail dans les médias et les productions culturelles pour éviter d’entretenir ces mythes et comprendre les mécanismes qui les sous-tendent.
La culture du viol est si omniprésente qu’on ne la discerne plus et s’en débarasser demandera, en France comme ailleurs, un travail de longue haleine. Face aux rejets exprimés contre ces changements, Valérie Rey-Robert rappelle l’essentiel: «[…] la jouissance masculine ne [peut] se réaliser […] sur la souffrance féminine. La lutte pour mettre fin aux violences sexuelles n’a pas à avoir d’autre but en soi, cela en est un suffisant. Et si elle doit passer par le fait de repenser nos rapports amoureux, c’est plutôt une chance, une promesse, qu’une crainte.»